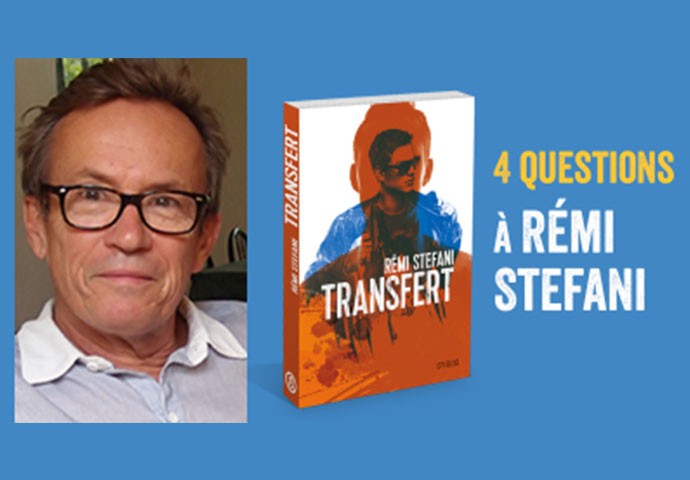
Transfert de Rémi Stefani - 4 questions
#1 Tout semble opposer Victor et Valentin : l’un est surdoué et vit à Paris, l’autre est plutôt mauvais élève et vit dans le Sud de la France… Comment font-ils pour accepter leur nouvelle identité ?
Victor et Valentin ne sont pas si différents car ils ont un point commun essentiel : leur passé a volé en éclats et ils sont contraints de se glisser dans la peau d’un autre. Cette situation les force à s’interroger sur ce qu’ils sont, sur ce qu’ils ont envie de faire de leur vie. En quelque sorte, ils sont condamnés à l’empathie et c’est ce qui va les sauver, au bout du compte. Se mettre à la place de l’autre exige des efforts, une forme de renoncement. Cela vous oblige à accepter les différences et c’est peut-être une des clefs du bonheur. Quand on déchiffre mieux le monde, il devient plus facile d’y trouver sa place.
#2 A travers cette idée de « renaissance » ou de « réincarnation », quel message vouliez-vous adresser à vos lecteurs ?
En fait, j’écris plus pour répondre aux questions que je me pose et pour les partager avec mes lecteurs que pour adresser un message à qui que ce soit. J’ai toujours été fasciné par le hasard qui nous fait naître ici ou là, dans tel contexte social, religieux, géographie, etc. Pouvons nous corriger cette « injustice » potentielle, nous élever contre ce destin – ce déterminisme ? – qui semble décider de notre vie ? Enfin, être conscient du rôle que joue le hasard dans cette distribution des chances ne devrait-il pas nous rendre plus tolérant et moins égoïste ? Pour moi, ce roman a ressemblé à une expérience de laboratoire. J’ai imaginé une situation – un échange de personnalités -, j’y ai jeté deux personnages et j’ai regardé comment ils se débrouillaient. Au départ, j’ignorais tout de la fin. J’ai découvert l’histoire en même temps que mes « cobayes », ce qui explique d’ailleurs que j’aie mis tant de temps à l’écrire. Et finalement, je trouve que mes héros ne s’en sortent pas si mal, non ?
#3 Il y a un autre personnage important, Vital Mistraki, un détective qui fait de ce récit un vrai thriller. Vouliez-vous dés le départ introduire cette dimension ?
Oui, j’ai très vite senti la nécessité de ce personnage qui travers le récit en y portant un regard extérieur, à mi-chemin entre le narrateur et le lecteur. Dans 29 février (paru en 2011 chez Rageot), qui aborde les mêmes questions mais de façon très différente, c’est Achille qui tenait ce rôle. Mais Achille est une sorte de « Deus ex machina » qui tire l’histoire – très réaliste – vers le fantastique. Dans Transfert, c’est le contraire. Vital est proche de nous, il a le don de s’incruster dans le récit. Et comme il est malin et sympathique, il devient un véritable complice pour le lecteur. Vital a une autre utilité. La dimension irrationnelle de cette affaire lui échappe et, du coup, il ancre le récit. Grâce à lui, le roman change de genre, passe du fantastique au policier. D’une certaine façon, il apporte de la crédibilité à l’histoire.
#4 De la Sierra Leone à Mayotte, vous faites beaucoup voyager vos personnages et le lecteur. Pourquoi avoir donné une si grande part à l’ « ailleurs » ?
Peut-être parce que l’ailleurs m’a toujours fait rêver. Entre 10 et 12 ans, je dévorais les innombrables tomes de la collection « Contes et légendes de » et chaque soir, je partais en voyage au Japon, en Grèce, chez les Incas ou les Inuits. Par la suite, j’ai taillé la route en compagnie de Kipling, Conrad, London, Kessel, Monfreid. Mes parents étaient aussi de grands voyageurs. Ils m’ont sans doute transmis le virus. L’ailleurs est le lieu des rencontres improbables qui vous déstabilisent en même temps qu’elles vous construisent. Partir – loin et seul ! – est un bon moyen de faire le point sur soi-même. Vos habitudes, vos a priori et vos certitudes disparaissent et c’est vierge de tout ce fatras culturel que vous affrontez l’inconnu. L’image que l’on vous renvoie de vous-même est alors sûrement assez proche de la vérité.