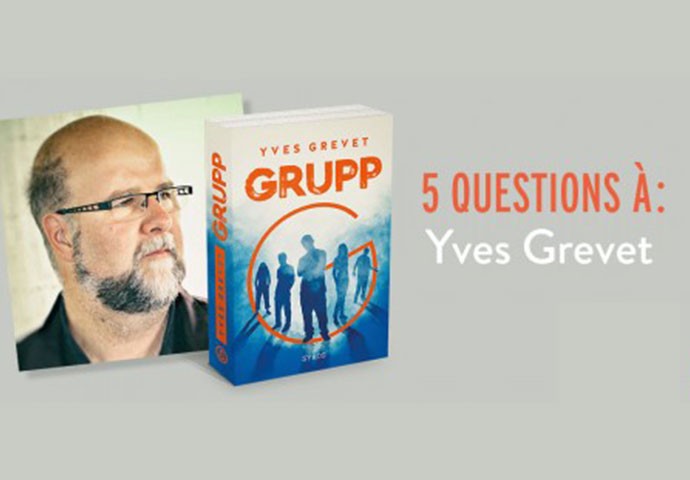
GRUPP - 5 questions à Yves Grevet
#1 Yves Grevet, qu’est-ce que le Grupp ? Pourquoi ce nom ?
Le Grupp est une organisation clandestine de lycéens qui revendique plus de liberté et moins de contrôle dans une société obnubilée par sa sécurité. Le mot se prononce Groupe et son orthographe se veut en rupture avec les règles des adultes. Puisqu’elle est libre et différente.
#2 Votre roman est construit en trois parties aux tonalités bien distinctes, qui s’éclairent mutuellement. Comment avez-vous conçu votre intrigue ?
Le Grupp est d’abord un récit à deux voix, celles de deux frères, Stan et Scott, qui ont trois ans de différence. Ce sont deux visions d’une société qui se confrontent, l’un accepte ses règles vues comme immuables, l’autre les a remises en cause et tente de vivre autrement. L’un espionne le Grupp et l’autre a participé à sa création. Et ces deux points de vue sont légitimes. La troisième partie donne la parole à plusieurs voix, celles de membres du Grupp qui voient enfin leurs espérances être entendues. Un nouveau livre est toujours le produit de ceux qu’on a écrits avant. Dans Nox, on suivait quatre narrations avec des personnages, à la première personne, qui se croisaient. Dans L’accident, on découvrait, après un premier récit réaliste mais comportant des zones d’étrangeté, un second plus inattendu qui le décodait. Le Grupp s’inspire de ces deux expériences. J’essaie à chaque fois de rendre compte de la complexité du monde au travers d’interprétations personnelles différentes d’une même réalité.
#3 Le Grupp est-il un roman d’espionnage ? Est-ce un genre que vous affectionnez ?
Je suis fasciné par le monde de l’espionnage depuis très longtemps. C’est le genre que je préfère. Je lis et je vois beaucoup de fictions sur le sujet mais également des récits historiques ou d’actualité. Dans Le Grupp, on retrouve les codes du genre, comme les réunions clandestines, les personnages infiltrés, les messages secrets, des manipulations et la désinformation. Cela apporte des retournements de situations, des surprises. On est dans l’angoisse permanente que la vérité puisse être découverte. Mais à la différence des romans classiques d’espionnage, il manque la dimension géostratégique. Dans d’autres de mes livres, on trouve des adolescents forcés un temps d’endosser le rôle d’espion, comme Ludmilla dans Nox ou Méto dans le troisième tome de la trilogie.
#4 Le thème de la prison, dont on ne ressort pas indemne, est central dans votre récit. Est-ce un sujet qui vous tient à cœur ?
La prison m’intéresse parce qu’elle est un monde clos avec ses propres règles, ses codes et ses rituels. Elle imprime sa marque à jamais sur celui qui la fréquente, Scott a l’impression d’être différent après sa sortie alors que sa peine n’a pas été si longue. C’est aussi l’endroit où la société relègue ceux qu’elle ne veut plus voir, en faisant semblant d’espérer que le seul isolement résoudra les problèmes. Pour mon héros, c’est un moment où il se confronte à une violence que son monde essaie le plus possible de cacher à la population. Les scènes en prison ont aussi une utilité romanesque parce qu’elles permettent de longues plages de solitude où le héros peut se poser pour analyser sa situation ou convoquer des souvenirs.
#5 Les héros de votre roman sont plus proches des lanceurs d’alerte d’aujourd’hui que des révolutionnaires des décennies passées. Qui sont-ils à vos yeux ?
Les lycéens du Grupp sont des pragmatiques. Ils ont des espérances mais n’attendent rien des adultes qui dirigent ou soutiennent la société dans laquelle ils vivent. Ils savent que depuis toujours,on décide à leur place ce qui est bon pour eux et que le pouvoir a tendance à réprimer les voix discordantes. Alors, ils ne baissent pas les bras et s’expriment anonymement sur les murs. Mais en parallèle, ils se débrouillent entre eux pour tenter de vivre ensemble des expériences qui les feront grandir et que la société leur interdit. Ils sont aussi plus critiques par rapport aux innovations technologiques qu’ils connaissent mieux que la génération précédente parce qu’ils en perçoivent les limites et les dangers.